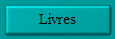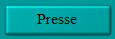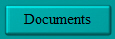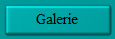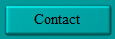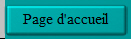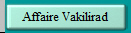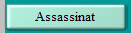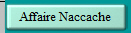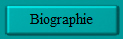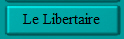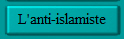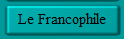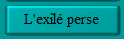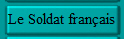1939: étudiant persan
cherche poste de combat
dans l'Armée française
La guerre éclate
J'étais à Juan-les-Pins lorsque la guerre éclata. On trouve dans la région plus d'oliviers que de baïonnettes et pourtant je pouvais faire mienne la réflexion écrite dans son Journal par André Gide, près d'un an plus tôt : «Aujourd'hui, dès le lever, me ressaisit l'angoisse à contempler l'épais nuage qui s'étend affreusement sur l'Europe, sur l'univers entier... La menace me paraît si pressante qu'il faille être aveugle pour ne la point voir et continuer d'espérer. » […]
Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclaraient la guerre à l'Allemagne, qui l'avait bien cherché.
Ma décision était prise ; je ne pouvais rester en dehors de cette aventure et tout m'indiquait la voie à suivre : m'engager dans l'Armée française en tant que volontaire. Je suis allé m'inscrire à Nice. Personne ne voulait de moi. On m'a répondu : « Vous habitez Paris, alors allez là-bas et débrouillez-vous ! »
C'était fantastique : nous venions offrir notre vie pour la Patrie et c'est ainsi qu'on nous traitait ! Discipliné, je suis rentré à Paris, j'ai frappé à toutes les portes. Un beau jour, l'administration militaire m'a fait connaître sa réponse: « Engagez-vous dans la Légion étrangère. »
J'ai refusé. Marié à une Française depuis plus d'un an, étant dans ma cinquième année de séjour en France, diplômé des universités françaises, je pensais avoir le droit d'être assimilé aux Français.
Les autorités ont fini par se ranger à mes arguments. Elles m'ont néanmoins fait languir encore de longs mois avant de me convoquer pour un examen médical. J'avais vingt-six ans, j'étais très sportif, le médecin me déclara bon pour le service.
La drôle de guerre
On a qualifié de « drôle de guerre » la période allant de la déclaration de guerre à mai 1940. C'était effectivement une drôle de guerre ; il m'a fallu attendre le mois de mars pour être enfin affecté à Orléans, au 30e Régiment d'artillerie.
Etant volontaire, j'avais pu choisir mon arme... Je me souviens d'avoir été versé dans la 98e batterie, puis à la 99e. Nous sommes partis à l'entraînement dans un petit village, près d'un vieux moulin, dans une campagne retirée. Un entraînement à la façon d'alors ; nous avions envie, à force de marcher, de retirer nos « godillots » et d'aller pieds nus.
Notre artillerie était décorée du mot avantageux d' « auto-tractée ». Pendant la retraite, nous serons obligés, sur l'ordre du capitaine qui, évidemment, obéissait au colonel du régiment, de brûler trois voitures qui ne pouvaient plus suivre. Elles avaient fait Verdun, elles dataient de 1915. Trente ans pour des voitures, avec l'entretien que cela comporte ! L'armement ne le cédait en rien aux véhicules pour la vétusté. Nous n'étions certainement pas un régiment d'élite, mais les régiments d'élite n'étaient pas mieux lotis. Aucune comparaison avec ce qu'avaient les Allemands, ni avec l'équipement qui sera celui des Américains.
Derrière la ligne Maginot
Une fois débrouillés, nous avons été envoyés comme troupe de couverture derrière la ligne Maginot. Je n'avais pas terminé mes classes d'élève-officier ; on a considéré opportun de m'affecter tout de suite à la conduite des véhicules. Pour les galons, on devait me les remettre plus tard, ce n'était d'ailleurs pas ce qui m'intéressait.
Nous sommes restés cantonnés environ un mois, n'ayant rien à faire, dans une tranquillité désespérante. A droite, la ligne Maginot, à gauche l'armée du général Huntziger. On évoquait régulièrement devant nous les percées auxquelles nous allions procéder dans le dispositif ennemi. Puis, un jour, on nous apprit que nous allions rejoindre un théâtre d'opérations situé à l'autre bout de la France : l'Italie venait de faire son entrée dans la guerre.
Encerclés par une unité ennemie
Trop tard, les Panzerdivisions déferlaient déjà, la limite était indécise entre le repli stratégique et la débandade. Je ne sais pas par quel miracle nous avons un soir échappé aux Allemands. Encerclés dans un bois obscur par une unité ennemie, nous nous croyions prisonniers, mais au petit matin, fait extraordinaire, il n'y avait plus personne. Nous avaient-ils déconsidérés? Avaient-ils mieux à faire que de s'occuper de nous ? Dans ses Mémoires de guerre, de Gaulle cite le cas de troupes françaises qu'ils désarmèrent avant de leur dire : « Prenez la route du sud comme les autres, nous n'avons pas le temps de vous faire prisonniers. » Peut-être étions-nous dans la même situation, à part que le temps, manquant encore davantage, n'avait même pas permis le contact entre eux et nous.
Armistice
Nous sommes arrivés à Clermont-Ferrand, puis avons obliqué vers l'Ouest, non loin de Carcassonne, pour aboutir à Lannemezan où se trouve une gare de triage ; une des voies qui s'en échappent nous a déposés à Tri-sur-Baïse, dans les Pyrénées. Impossible d'aller plus loin, après c'était l'Espagne.
Nous sommes restés dans ce village deux mois, tandis que l'armistice était signé et la ligne de démarcation entre France libre et France occupée mise en place. Deux mois d'un profond ennui ; nous organisions des excursions.
J'ai envisagé de passer la frontière pour continuer la lutte ailleurs ; je crois qu'au fond de moi-même je n'y étais pas disposé.
Anti-défaitisme chevillé au corps
Il y a une chose, en tout cas, dont j'étais sûr, dont je n'ai jamais douté une seconde : la défaite allemande. A l'époque, on plaisantait de l'affirmation du pauvre Reynaud : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. » Eh bien, il disait vrai, cela s'est réalisé plus tard.
Mon premier contact avec la prison s'est effectué en France, sous l'uniforme. Je me suis battu avec un camarade défaitiste qui prédisait comme inéluctable la domination définitive de la France, de l'Angleterre par Hitler. J'avais la conviction du contraire. Nous avons écopé de quinze jours d'arrêts chacun.